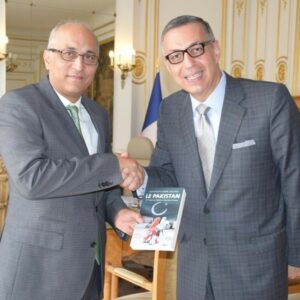Sept mois après l’offensive éclair des djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham qui a renversé le régime de Bachar al-Assad, la Syrie s’enlise dans la violence et les minorités en sont les premières victimes.
Meurtri par treize ans de guerre civile, le pays est confronté à un engrenage de vengeances communautaires. Les nouvelles autorités, incapables d’assurer la sécurité du pays, sont dépassées par les milices qui les ont appuyées pour prendre le pouvoir.
Minorités décimées
Alors qu’en mars dernier, plus de 1 000 Alaouites – minorité dont est issu Bachar al-Assad – ont été massacrés dans la région côtière de l’est du pays, les enlèvements de femmes alaouites se multiplient, rappelant le terrible sort réservé aux femmes yézidies [minorité ethnique et religieuse kurdophone du nord de l’Irak, ndlr] par les bourreaux de Daech entre 2014 et 2017.
Le 22 juin dernier, ce sont les chrétiens qui ont été ciblés par un attentat sanglant contre l’Église grecque orthodoxe de Saint-Élie à Damas, faisant 25 morts et 63 blessés. D’abord attribué à l’État islamique, cet attentat a été revendiqué par le groupuscule terroriste “Saraya Ansar el-Sunna” qui, d’après les experts, serait composé d’anciens partisans de Hayat Tahrir al-Cham devenus dissidents.
Alors que la proportion de chrétiens en Syrie a drastiquement baissé depuis le début du conflit en 2011, passant d’environ 1,5 million à seulement 300 000 fidèles aujourd’hui, le patriarche orthodoxe d’Antioche a déclaré pendant la messe des victimes que le gouvernement du président Ahmed Al-Charra portait la responsabilité de ne pas protéger les minorités et que ses condoléances ne suffisaient pas.
Affrontements et revirements
Le sud du pays est aussi confronté à de violents affrontements entre des tribus bédouines sunnites, la communauté druze et les forces gouvernementales, faisant plus de 500 morts depuis dimanche 13 juillet.
Après être entrée mardi 15 juillet dans la ville de Soueïda, l’armée syrienne a été sommée de s’en retirer par Israël, qui a bombardé des sites des forces gouvernementales à Damas, affirmant protéger les minorités druzes tout en maintenant ses positions sur le Golan. Le président syrien, qui veut éviter un conflit ouvert avec Israël, s’est exécuté et a annoncé transférer “à des factions locales et des cheiks” druzes la responsabilité du maintien de la sécurité à Soueïda.
Enfin, l’accord du 10 mars dernier entre Damas et les Kurdes pour l’intégration de ces derniers à l’administration syrienne n’est toujours pas appliqué. Mazloum Abdi, le dirigeant militaire des Kurdes, a renouvelé sa préférence pour une administration décentralisée, refusant de céder aux pressions américaines. Échaudés par le déchaînement de violence et le sort réservé aux minorités, les Kurdes, qui avaient noué des alliances de circonstance avec le régime d’Assad pour contenir les manœuvres militaires turques, rechignent à se désarmer.
Les États-Unis à la manœuvre
Alors que les États-Unis, méfiants jusqu’alors, conditionnaient leur appui à des garanties “d’inclusion”, la menace d’un chaos généralisé les conduit, pour rétablir l’ordre, à miser sur les islamistes qui ont investi le pouvoir.
Affilié par le passé à Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Cham n’est plus considéré comme une organisation terroriste par le département d’État américain et le mandat d’arrêt contre son chef Ahmed al-Charaa – djihadiste relooké devenu président – est tombé. Les sanctions contre la Syrie ont été officiellement levées par Donald Trump à l’occasion de son déplacement en mai dernier dans les pétromonarchies.
Washington est même revenu sur ce qui était jusqu’à présent sa ligne rouge : autoriser les 3 500 djihadistes étrangers à intégrer l’armée syrienne, afin qu’ils ne se jettent pas dans les bras de l’État islamique qui reconstitue ses forces dans certaines localités du pays.
Les États-Unis ne voient sans doute pas dans les nouvelles autorités syriennes des démocrates, mais ils espèrent éviter la désintégration de l’État syrien dont les conséquences géopolitiques seraient dramatiques.
Cependant, rien n’indique pour le moment que ce pari puisse être gagné. Les nouvelles autorités syriennes disent vouloir réconcilier les Syriens pour obtenir la bénédiction de la communauté internationale, mais les faits sont têtus et trahissent pour l’instant leurs paroles.
Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si la Syrie bascule à nouveau dans le chaos ou si la patience des Occidentaux et des États du golfe Persique avec le nouveau maître de Damas permet la stabilisation du pays. Mais à quel prix…
Ardavan Amir-Aslani et Sixtine Dupont dans Le nouvel Economiste le 17/07/2025