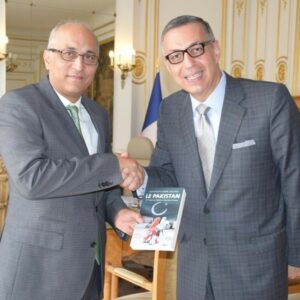Une semaine après l’annonce du cessez-le-feu entre Téhéran et Tel-Aviv, l’avenir du Moyen-Orient reste en suspens. Bien que respectée, cette paix demeure fragile. L’ampleur des dégâts causés par les raids américains sur les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan est encore méconnue et le doute plane quant à la véracité du transfert sur des sites cachés par les Iraniens de 400 kilos d’uranium hautement enrichi.
Pourtant, malgré ses déclarations contradictoires, Donald Trump espère profiter de l’affaiblissement de l’Iran pour le forcer à revenir à la table des négociations. La raison commanderait que l’Iran accepte pour obtenir enfin la levée des sanctions qui asphyxient son économie et sa population civile.
Rupture de confiance
Mais la reprise du dialogue s’avère plus délicate que jamais. Tout d’abord, la fragile confiance qui régnait entre Washington et Téhéran est rompue. Après s’être retiré unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018, Donald Trump a renoué avec sa politique de pression maximale. Alors que les négociations achoppaient sur le fameux taux d’enrichissement d’uranium et qu’une nouvelle réunion américano-iranienne devait se tenir à Mascate, le président américain a privilégié une solution militaire, prenant à rebours sa base électorale à qui il avait promis la fin des expéditions militaires nébuleuses.
Les récentes joutes verbales entre Washington et Téhéran n’ont rien arrangé. Alors que le guide suprême déclarait avoir infligé une “gifle cinglante” aux États-Unis, Donald Trump lui a répondu en se vantant d’être celui qui l’avait épargné d’une mort “affreuse”, déchaînant les partisans du régime.
Inflexibilité côté iranien
Si la classe politique iranienne était déjà divisée sur le bien-fondé des négociations avec les États-Unis, les frappes américaines ont renforcé l’intransigeance du camp conservateur. Ce dernier, prenant exemple sur le Pakistan, est désormais plus convaincu que jamais que le programme nucléaire est son assurance-vie pour sanctuariser son territoire et se maintenir au pouvoir.
Tandis que toutes les inspections demandées par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont été refusées, le parlement iranien a approuvé un projet de loi visant à suspendre sa coopération avec l’agence onusienne. Le régime reproche à la résolution de l’AIEA du 12 juin 2025, accusant l’Iran de non-respect de ses obligations nucléaires, d’avoir servi de prétexte à Israël pour conduire son offensive.
Le président iranien Masoud Pezeshkian, qui jusqu’à présent restait prudent et laissait une possibilité à la reprise du dialogue, a pourtant ratifié mercredi 2 juillet la suspension de cette coopération. Abbas Araghtchi, son ministre des Affaires étrangères, a rappelé à plusieurs reprises que l’Iran ne négocierait pas sous la menace de bombardements et a exigé des garanties de Washington.
Israël fauteur de troubles
Enfin, si Tel-Aviv a accepté le cessez-le-feu sous la pression des missiles iraniens, Benjamin Netanyahu, qui ne cesse de militer en faveur d’un changement de régime en Iran, risque de compliquer la reprise des négociations.
En dépit de ces obstacles, Washington et Téhéran parviendront-ils à surmonter l’hubris ? Donald Trump en a besoin s’il veut rester fidèle à ses engagements de campagne et obtenir le prix Nobel de la paix qu’il convoite tant. Quant à Téhéran, sa situation économique exsangue et la détresse de sa population l’obligeront sans doute à faire des concessions.
Ardavan Amir-Aslani et Sixtine Dupont dans Le nouvel Economiste le 03/07/2025
© SIPA